Section 3.4 Retour au(x) réel(s) : la tribu de Borel
Pour notre problème d'intégrer des fonctions réelles, il nous fallait déterminer les ensembles sympathiques de \(\R\text{.}\) C'est Borel qui les a trouvé dans les profondeurs de la forêt amazonienne: et l'idée, c'est de tenir compte du fait que \(\R\) n'est pas un ensemble complètement déstructuré: \(\R\) est un espace topologique.
....
...C'est-à-dire ?
On dit qu'un ensemble \(\Omega\) est un espace topologique 1 , s'il a des sous-ensembles ouverts (et donc, leurs complémentaires sont des ensembles fermés). Par exemple, \(\R\) est un espace topologique: un sous ensemble \(U\subset \R\) est un ouvert si
Et plus généralement, si \((E, \|.\|)\) un espace vectoriel muni d'une norme, on peut s'en servir pour définir
une distance,
donc des boules,
donc des voisinages,
donc des ouverts.
donc des fermés,
et donc grâce à la distance, on a des suites convergentes et des fonctions continues.
\(\leadsto\) Ce sont les espaces sur lesquels on va pouvoir faire de l'analyse: c'est pour ça que la notion d'ouverts d'un ensemble (ce qu'on appelle "la topologie") est importante.
\(\leadsto\) Tous les e.v.n. sont des espaces topologiques. 3
Et encore plus généralement, si on a un sous-ensemble \(X\subset (E,\|.\|)\) d'un espace vectoriel normé, la topologie induite 5 nous permet de mettre des ouverts et des fermés sur \(X\text{,}\) et donc d'en faire un espace topologique.
On appelle dans ce cas ouvert de \(X\) tout sous-ensemble \(A\subset X\) de la forme \(A=X\cap U\text{,}\) où \(U\) est un ouvert de \(E\text{.}\)
De là:
Proposition 3.4.1.
Soit \((\Omega,\O_{\Omega})\) un espace topologique, avec \(\O_{\Omega}\subset\mathcal{P}(\Omega)\) la famille de tous ses ouverts.
On appelle tribu de Borel sur \(\Omega\text{,}\) notée \(\mathscr B(\Omega)\text{,}\) la tribu engendrée par la famille des ouverts de \(\Omega\text{.}\) Ses éléments sont appelés les boréliens de \(\Omega\text{.}\)
Et du coup, on appelle tribu des boréliens de \(\R\) la tribu engendré par les ouverts de \(\R\text{.}\)
Dans le cas des réels, la tribu \(\mathscr B(\mathbb R)\) contient donc aussi
Tous les ouverts et fermés de \(\mathbb R\text{;}\)
Tous les intervalles: par exemple, \(\rbb a,b\rbb = \bigcap_n \lbb a- \frac 1n, b \rbb \)
Tous les singletons \(\{x\}\) (ce sont des fermés), donc, par union, tous les ensembles dénombrables
et d'autres ensembles plus exotiques, comme l'ensemble de Cantor 6 .
En particulier (et c'est le cas qui nous sera utile), si est une partie d'un espace vectoriel normé, on appelle ouvert de \(X\) tout sous-ensemble \(A\subset X\) de la forme \(A=X\cap U\text{,}\) où \(U\) est un ouvert de \(E\text{.}\) On notera alors \(\mathscr B(X)\) la tribu engendrée par les ouverts de \(X\text{.}\)
Et comme on a vu, la définition des ouverts de \(\R\) utilise des intervalles. Et en fait, tout ouvert de \(\R\) est une collection d'intervalles:
Proposition 3.4.2.
Soit \(U\subset\R\) un ouvert de \(\R\text{.}\) Alors \(U\) est une union dénombrable d'intervalles ouverts: il existe une famille dénombrable \(\mathcal{A}_{U}\subset \mathcal P(\R)\) d'intervalles ouverts telle que
Exercice 3.4.1. Preuve.
(a)
Démontrez-le !Considérer la famille
On pose, comme suggéré,
La famille \(\mathcal{A}_{U}\) est dénombrable: puisque \(\Q\) est dénombrable, \(U\cap\Q\) aussi, et \(\Q_{+}^{*}\) aussi.
Reste à vérifier que
On procède par double implication.
-
\(\boxed{\supset}\) Pour tout \(A=\lbb q-r,q+r \rbb\in\mathcal{A}_{U}\text{,}\) on a \(A\subset U\text{.}\) Donc \(\bigcup_{A\in\mathcal{A}_{U}}A\subset U\text{.}\)
C'était l'inclusion facile !
-
\(\boxed{\subset}\) Soit \(x\in U\text{,}\) on cherche \(A\in\mathcal{A}_{U}\) tel que \(x\in A\text{.}\)
Donc, on cherche \(q_{x}\in U\cap\Q,r_{x}\in\Q_{+}^{*}\) tels que \(x\in\lbb q-r,q+r \rbb \subset U\text{.}\)
Remarquons déjà que, puisque \(U\) est ouvert, il existe \(\rho \gt 0\) tel que \(\lbb x-\rho,x+\rho \rbb \subset U\text{.}\) Par densité de \(\Q\) dans \(\R\) 7 , on sait qu'il existe un rationnel \(r\) dans l'intervalle \(\lbb 0,\rho \rbb\text{:}\) on a alors
\begin{equation*} \lbb x-r,x+r \rbb \subset \lbb x-\rho,x+\rho \rbb \subset U. \end{equation*}A partir de là, deux cas se présentent:
Cas 1: \(\boxed{x\in\Q}\). Dans ce cas, tout simplement, on prend \(q_{x}=x\) et \(r_{x}=r\text{.}\)
-
Cas 2: \(\boxed{x\notin\Q}\). Dans ce cas, par densité de \(\Q\) dans \(\R\text{,}\) il existe un rationnel \(q\in \lbb x-\frac{r}{2},x+\frac{r}{2} \rbb\text{.}\) Mais alors,
\begin{equation*} x-r \lt q-\frac{r}{2} \lt x \lt q+\frac{r}{2} \lt x+r \end{equation*}donc
\begin{equation*} x\in\lbb q-\frac{r}{2},q+\frac{r}{2} \rbb \subset \lbb x-r,x+r \rbb \subset U. \end{equation*}\(\leadsto\) On prend \(q_{x}=q\) et \(r_{x}=\dfrac{r}{2}\text{.}\)
(b)
Montrer de la même façon que, pour tout \(n\in\N\text{,}\) tout ouvert de \(\R^n\) est une union dénombrable de boules ouvertes.
\(\leadsto\) On dit que les intervalles ouverts \(\lbb a,b\rbb\) forment une base dénombrable de la topologie sur \(\R\) (et les boules ouvertes sont une base dénombrable de la topologie sur \(\R^n\)).
On en déduit que la tribu engendrée par les ouverts de \(\R\) est la même que la tribu engendrée par les intervalles ouverts de \(\R\text{:}\)
Et de là, en jouant avec les passages au complémentaire et les unions et intersections dénombrables, on trouve toutes sortes de familles d'intervalles qui engendrent \(\mathscr{B}(\R)\text{.}\)
Lemme 3.4.3.
La tribu des boréliens de \(\mathbb R\) est engendrée par certaines familles de sous-intervalles:
Preuve.
On montre les égalités de la première ligne; les autres se démontrent de façon similaire. Notons \(\mathscr O\) la famille des ouverts de \(\mathbb R\text{.}\)
Pour tout \(a\in \mathbb R\text{,}\) \({\lbb a, +\infty\rbb }\in \mathscr O\text{,}\) donc \(\sigma(\{{\lbb a, +\infty\rbb },\, a\in \mathbb R\}) \subset \sigma(\mathscr O) = \mathscr B(\mathbb R)\text{.}\)
Réciproquement, tous les intervalles ouverts de \(\mathbb R\) sont dans \(\mathscr T=\sigma(\{{\lbb a, \infty\rbb },\, a\in \mathbb R\})\text{.}\) En effet, pour tous \(a,b \in \mathbb R\)
\({\rbb a,+\infty\rbb } = \bigcap {\lbb a-\frac 1n, +\infty\rbb } \in \mathscr T\text{,}\) donc \({\lbb - \infty,a\rbb }={\rbb a,+\infty\rbb }^c \in \mathscr T\text{;}\)
\(\displaystyle {\lbb a,b\rbb } = {\lbb - \infty,b\rbb } \cap {\lbb a, +\infty\rbb } \in \mathscr T\)
Soit \(U\subset \mathbb R\) un ouvert. Pour \(x\in U\text{,}\) on note \(I_x = \bigcup \{ I \text{ intervalle},\, I\subset U,\, x \in I\}\) le plus grand intervalle contenu dans \(U\) et contenant \(x\text{.}\) Alors, pour tout \(y\in I_x\text{,}\) on a \(I_x = I_y\text{.}\) De plus, pour tout \(x\text{,}\) \(I_x\) est un intervalle non vide, donc il existe un rationnel \(q\in I_x\text{,}\) et \(I_q = I_x\text{.}\) On en déduit que
donc \(U\) est une union dénombrable d'intervalles ouverts. Donc \(U\in \mathscr T\text{.}\)
Enfin, on a \(\sigma(\{\lbb a, +\infty\rbb ,\, a\in \mathbb Q\}) \subset \sigma(\{\lbb a, +\infty\rbb ,\, a\in \mathbb R\})\text{.}\) Réciproquement, pour tout \(a\in \mathbb R\text{,}\) il existe une suite \((a_n)_n\) de rationnels décroissant vers \(a\text{,}\) d'où
donc \(\lbb a, +\infty\rbb \in \sigma(\{\lbb a, +\infty\rbb ,\, a\in \mathbb Q\})\text{.}\)
Parfois, il n'est pas très pratique de parler des boréliens de \(\R\) tout entier, si on ne s'intéresse qu'à un sous-ensemble \(X\subset \R\text{.}\)
Mais, à coup de topologie induite, pour n'importe quel sous-ensemble \(X\) de \(\R\text{,}\) on sait sont les ouverts de \(X\): ce sont les ensembles du type
et donc on peut définir les boréliens de \(X\text{:}\)
En fait, la tribu \(\mathscr{B}(X)\) est la tribu-trace 9 de \(\B(\R)\) sur \(X\text{:}\)
Petit Exercice 3.4.4.
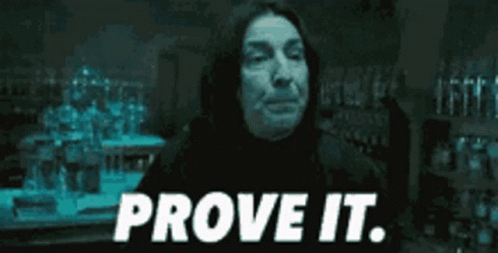
Exercice 3.4.2. Un borélien qui n'est pas un intervalle.
On considère l'ensemble
Le but du jeu est de montrer que c'est un borélien !
(a)
Montrer que \(A\) n'est pas un ouvert de \(\rbb 0 , 1 \lbb\text{.}\)
Pire que ça, montrer que \(int(A)=\emptyset\text{.}\)
(b)
Montrer que \(A\) n'est pas non plus un fermé.
(c)
Montrer que \(A\) est un borélien de \(\rbb 0,1 \lbb\text{.}\)
www.bibmath.net/dico/index.php?action=affiche&quoi=./t/topologie.htmlwww.bibmath.net/dico/index.php?action=affiche&quoi=./d/distance.htmlcarolinevernier.website/topo_induite.pdffr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_de_Cantorcarolinevernier.website/memos/densite_rationnels.pdf

